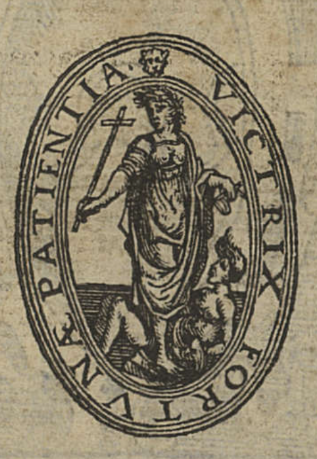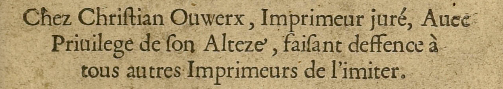Imprimer la loi à Liège aux XVIe-XVIIIe siècles
L’histoire des débuts de l’imprimerie à Liège est intimement liée à la reproduction d’actes officiels. En effet, le fondateur de la tradition typographique liégeoise, Gauthier Morberius (Walter Morbiers), vient s’installer en bord de Meuse, dans le courant de l’année 1555, à la demande des autorités communales. Sa situation est sécurisée trois ans plus tard par l’octroi du titre d’imprimeur juré et d’un monopole sur l’impression des édits et mandements du prince-évêque.
En ce milieu du XVIe siècle, l’administration est confrontée à une multiplication inédite d’actes publics et trouve dans l’imprimerie un nouvel outil de médiation de ses décisions dans l’espace urbain. Cet art permet en outre un abaissement des coûts de production, une réduction du temps de copie et une augmentation considérable des possibilités de diffusion des textes. Le nouveau média transforme en profondeur les modes de communication entre le pouvoir et la population. L’imprimerie contribue ainsi à instaurer une nouvelle visibilité de l’autorité et renforce, au passage, le contrôle social par la diffusion rapide et uniforme des injonctions princières.
Mandements et ordonnances
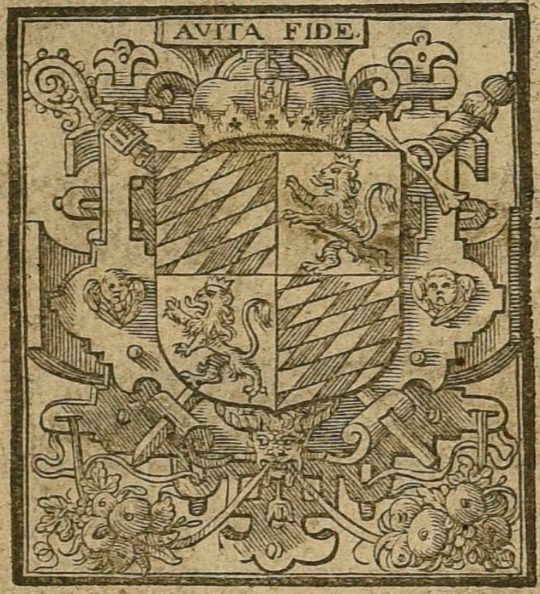 Les manifestations matérielles du pouvoir édictal du prince-évêque se déclinent en trois catégories. La première, qui reprend les mandements épiscopaux, correspond aux actes émis par le prince en sa qualité de dignitaire ecclésiastique. Ces documents, contresignés par le vicaire général, concernent les matières relevant du droit canon et de la discipline ecclésiastique. Les domaines soumis au pouvoir temporel du souverain liégeois sont, quant à eux, régulés par des ordonnances de police générale portant le contreseing du chancelier. Enfin, les textes émis conjointement par le prince et les États sont communément appelés mandements exécutoires. Quelle que soit la catégorie, le prince seul détient le droit de promulguer des ordonnances.
Les manifestations matérielles du pouvoir édictal du prince-évêque se déclinent en trois catégories. La première, qui reprend les mandements épiscopaux, correspond aux actes émis par le prince en sa qualité de dignitaire ecclésiastique. Ces documents, contresignés par le vicaire général, concernent les matières relevant du droit canon et de la discipline ecclésiastique. Les domaines soumis au pouvoir temporel du souverain liégeois sont, quant à eux, régulés par des ordonnances de police générale portant le contreseing du chancelier. Enfin, les textes émis conjointement par le prince et les États sont communément appelés mandements exécutoires. Quelle que soit la catégorie, le prince seul détient le droit de promulguer des ordonnances.
Ces textes officiels ne contiennent pas systématiquement des règles de droit. Ils peuvent également porter sur des mesures d’exécution relatives à la sphère publique, comme le nettoyage des espaces urbains, les patrouilles de police ou encore la réparation des routes. Leur publication pouvait prendre différentes formes : affiches in-plano ou placards, mais aussi brochures destinées à être distribuées aux autorités concernées. Les placards, ordonnances et autres édits, désormais reproduits en de multiples exemplaires, pouvaient être ainsi affichés sur les murs de la ville ou être diffusés dans les principaux lieux de rassemblement.
Gauthier Morberius, « imprimeur juré de son Alteze »
Le régime éditorial de la librairie d’Ancien Régime se caractérise par la concession, de la part des autorités civiles ou religieuses, de privilèges destinés à protéger, pour une durée variable, les productions d’un atelier d’imprimerie. À Liège, l’octroi de telles patentes relève du Conseil privé, qui agit au nom du prince-évêque. Cette forme de « copyright » avant l’heure peut concerner aussi bien un monopole sur l’impression et la diffusion d’une œuvre précise, que sur un secteur particulier – comme les gazettes et journaux – ou encore sur une catégorie de documents, en l’occurrence les impressions officielles.
La possession d’un monopole sur les édits du prince-évêque constitue pour son détenteur une source de revenus réguliers et sécurisés ; c’est pourquoi Morberius s’est empressé, tout au long de sa carrière, de faire renouveler son titre d’imprimeur de Son Altesse à chaque élection d’un nouveau souverain. Ses presses ont ainsi servi de relais aux décisions promulguées par Robert de Berghes (1557-1564), Gérard de Groesbeeck (1564-1580) et Ernest de Bavière (1581-1612). Une vingtaine d’actes imprimés à l’enseigne de La Patience sont encore conservés, bien que d’autres impressions, en raison de leur caractère éphémère, aient probablement disparu depuis le XVIᵉ siècle. Cette proximité avec le pouvoir a également permis à Morberius de se voir confier l’impression d’autres entreprises éditoriales d’envergures à caractère officiel, à l’instar des publications en lien avec la réforme tridentine, tels que les nouveaux manuels de liturgie ou encore l’Index des livres interdits, promulgué à Rome en 1564.
Vers la détention de monopoles dynastiques
À sa mort, en 1595, l’officine de Gauthier Morberius est partagée entre ses deux gendres, Léonard Streel et Christian Ouwerx. Son fils unique, Charles, est sourd et muet et se trouve dans l’incapacité de reprendre l’entreprise familiale. La maîtrise du monopole sur les imprimés officiels a été au cœur de stratégies familiales destinées à transformer ces licences en capital dynastique. Au début du XVIIe siècle, cette patente passe aux mains de la branche des Ouwerx. En 1643, Jean Ouwerx, fils de Christian Ouwerx et de sa seconde épouse, Marie Du Chesne, meurt sans laisser de postérité. Les Streel récupèrent alors dans leur giron le privilège sur les imprimés officiels.
Un édit de Jean-Louis d’Elderen (1688-1694) atteste néanmoins un partage des tâches d’impression entre deux familles d’imprimeurs liégeois, en fonction des instances émettrices. Ainsi, en 1688, le prince-évêque confirme les patentes accordées par son prédécesseur Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688) : d’une part à Jean-François de Milst, et d’autre part à la veuve de Léonard Streel, Hélène Hovius, et à son fils Guillaume-Henri. Ces familles devaient imprimer alternativement les mandements et ordonnances de Son Altesse et de son Conseil privé, selon la date de publication. En outre, Jean-François de Milst était chargé principalement de l’impression des mandements de la Chambre des comptes et des États, tandis que revenaient à la famille Streel les mandements du vicaire de l’évêque.
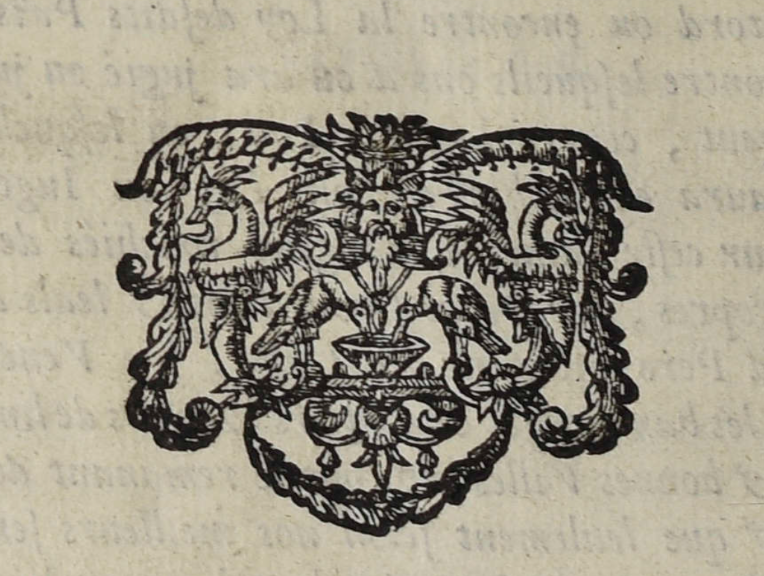 |
 |
 |
Cette organisation bipartite perdure tout au long du XVIIIᵉ siècle et, avec l’extinction des anciennes grandes dynasties de typographes, les monopoles passent dans les escarcelles des familles Barnabé, Kints et Sylvestre. Il faut attendre la chute de l’État liégeois et l’annexion du territoire à la République française pour voir disparaître le régime des privilèges d’imprimerie.
La liste des actes officiels publiés dans l'ancienne Principauté de Liège, depuis Gérard de Groesbeeck jusqu'à la Seconde période française, conservés à l'université de Liège, est accessible via le site d’ULiège Library.
Pour en savoir plus :
- DER WEDUWEN, A., State Communication and Public Politics in the Dutch Golden Age, Oxford, Oxford University Press, 2023.
- ADAM, R., "Printing for Central Authorities in the Early Modern Low Countries (15th–17th Centuries)", in N. Lamal, J. Cumby & H. J. Helmers (éds), Print and Power in Early Modern Europe (1500–1800), Leyde – Boston, Brill, 2021, p. 64-85.
- AFONSO, S., "Imprimer pour le prince-évêque : les mandements épiscopaux liégeois entre pouvoir et marché", in Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, 69 (2011), p. 1-17.
- HANSOTTE, G., PIEYNS, J., Inventaire analytique de la collection des placards imprimés liégeois, 4 t., Bruxelles, AGR, 1974.
* Auteur du blog : Renaud ADAM (ULiège Library)
* Citer ce blog : Renaud ADAM, "Imprimer la loi à Liège aux XVIe-XVIIIe siècles", Blog de DONum (https://donum.uliege.be/news?id=62) (ISSN 3041-4547) (septembre 2025).